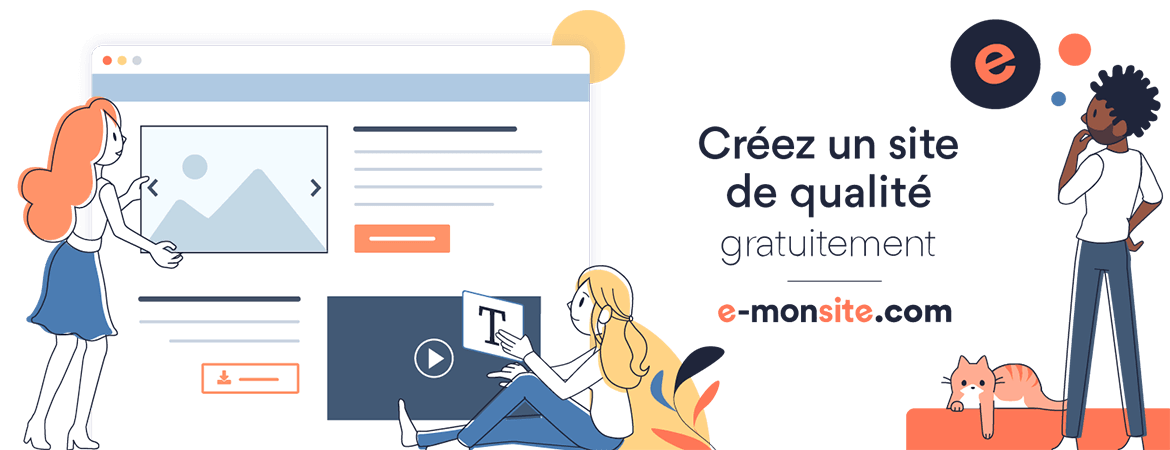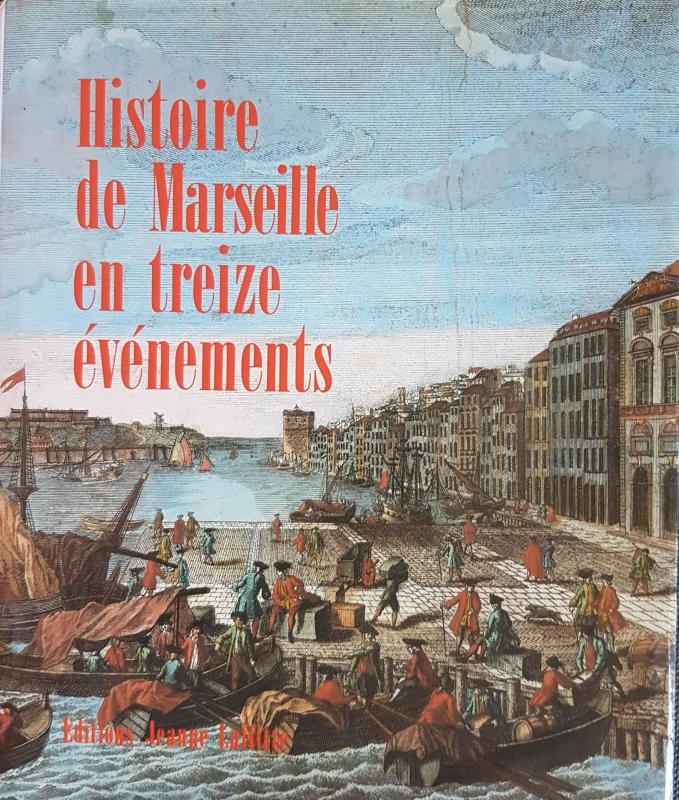Marseille, une ville aux atouts nombreux
De nos jours, on n’associe pas spontanément Marseille avec la Résistance. En effet, celle-ci est plus communément liée à la ville de Lyon d’où opéraient Jean Moulin et les principaux réseaux. Allant dans ce sens, on ne trouve pas à Marseille, un mémorial en souvenir de cette période : seulement des noms de rues et des plaques commémoratives. Cela nous a interpellé, en effet, pourquoi n’y en-a-t-il pas, alors que dès l’été 1940, bien avant que le mot résistance lui-même ne soit utilisé, certaines personnes se livraient à des activités de résistance, à Marseille ? Plus grande ville et surtout seul port encore en activité de la zone libre, Marseille attira une multitude de réfugiés (des Français de la zone occupée et d’Alsace-Lorraine, des soldats britanniques, des Belges, des Tchèques, des Polonais, des Italiens opposants au fascisme, des Allemands opposants au nazisme, des communistes et des anarchistes espagnols) qui commencèrent à converger dès mai 1940.
Dans l’ouvrage Histoire de Marseille en treize évènements d'un collectif d'historiens, préfacé par Jean-Claude GAUDIN, publié en 1998, on nous explique qu’à Marseille, la résistance avait été assez précoce. Les Marseillais eurent même le privilège de pouvoir lire l’appel du 18 juin 1940 dans les journaux de la ville. Par ailleurs, Henri Frenay avait recruté des résistants parmi des officiers : ce qui fut à l’origine du Mouvement Combat et de l’Armée Secrète. Sous l’impulsion de Gaston Deferre, la résistance socialiste avec ses milices fut plus dynamique qu’ailleurs.
On nous dit aussi qu’il y a eu des communistes, d’abord en petits groupes plus ou moins marginaux avant l’entrée en guerre des Soviétiques, puis en masse après 1941 et des chrétiens, comme des dominicains de la rue Edmond Rostand ou les pasteurs protestants. Comme nous avons pu le dire auparavant, ces historiens souligne que les étrangers ont joué un rôle très important dans cette résistance : Italiens antifascistes ou Allemands antinazis mais aussi des Républicains Espagnols ou émigrés d’Europe centrale. Les manifestations du refus furent très variées : aide aux Juifs et aux étrangers pourchassés, manifestations publiques contre Laval (en octobre 1942), attentats contre les collaborateurs ou les Allemands, sabotages, renseignements, propagandes auprès de la population mais aussi des troupes allemandes.
Enfin, on nous fait part que la répression fut à la mesure de cette résistance, dangereuse et efficace avec la Gestapo de la rue Paradis et le redoutable Dunker, dont le rapport Flora consacré aux structures de l’ensemble de la résistance, aboutit à l’arrestation de l’Armée Secrète, le Général Delestraint et indirectement à celle de Jean Moulin. Elle s’appuya aussi sur des collaborateurs violemment antisémites du P.P.F. de Sabiani avec le relai des bandes de Carbone et de Spirito. Quatre jours après le débarquement de Provence, les organisations de la résistance déclenchent une grève insurrectionnelle et le 21 août, Marseille se couvre de barricades, mais les véritables combattants sont peu nombreux, mille environ qui s’opposent à plus de vingt mille Allemands, solidement retranchés sur les points élevés de la cité. Heureusement, le Général de Montsabert arrache l’autorisation de foncer sur Marseille, qu’il atteint avec ses tirailleurs algériens par le massif de l’Etoile, le 23 août. Les combats durent alors jusqu’au 28 août.